L'intrépide Jeanne Barret : la première femme à faire le tour du monde
J’aime l’histoire des femmes. Et des femmes extraordinaires, il y en a eu. Parmi les récits d’aventures celui de Jeanne Barret se distingue par son audace et sa détermination. Nous sommes au XVIIIe siècle. Femme d’origine modeste, botaniste passionnée, elle est la première femme connue à avoir accompli un tour du monde, elle s’est battue contre les conventions sociales de son époque, bravant mille dangers pour s’imposer dans un domaine exclusivement masculin. Sans pour autant vouloir changer les normes de son époque, elle a participé comme tant d’autres avant à démontrer l’exceptionnelle force et courage des femmes face à l’adversité. Ce voyage, qu’elle entreprit travestie en homme, est une véritable odyssée où intelligence et ténacité s’entremêlent pour dessiner l’histoire d’une héroïne méconnue. Plongeons dans cette aventure extraordinaire.
Jeanne Barret naquit en 1740 dans le petit village de La Comelle, en Bourgogne. La vie y était rude : entourée de collines boisées, de champs de céréales et de vignobles, la région était dominée par une économie agraire. Jeanne grandit dans une ferme modeste, où les journées étaient rythmées par les travaux des champs et les soins aux animaux. Dans cette France rurale, les femmes avaient peu d’opportunités au-delà de la sphère domestique. Mais Jeanne, curieuse de nature, développa une connaissance approfondie des plantes locales. Peut-être observait-elle, fascinée, les herbes médicinales que les villageois utilisaient pour soigner les maladies, ou s’aventurait-elle dans les forêts environnantes pour ramasser des spécimens qu’elle étudiait en secret. Cette expertise botanique allait bientôt devenir sa porte de sortie vers un destin hors du commun.
En quête d’une vie meilleure, Jeanne quitta son village natal pour Autun. Là, elle rencontra Philibert Commerson, un naturaliste renommé qui cherchait une gouvernante. Plus qu’une simple employée, Jeanne devint rapidement sa confidente et son assistante. Leur relation dépassa bientôt le cadre professionnel, et tous deux formèrent un partenariat intellectuel et amoureux. Commerson, veuf et malade, reconnaissait le talent de Jeanne pour la botanique. Elle l’aidait dans ses recherches, classant ses spécimens et participant à ses observations. Ensemble, ils partageaient une passion pour les sciences naturelles, une passion qui allait les conduire bien au-delà des frontières de la France. En 1766, lorsque Louis Antoine de Bougainville proposa à Commerson de rejoindre son expédition autour du monde, ce fut une opportunité unique. Mais pour Jeanne, femme dans une société qui interdisait l’accès des navires royaux aux femmes, c’était un obstacle monumental.
Déterminée à accompagner Commerson, Jeanne élabora un plan risqué. Elle se travestirait en homme, couperait ses cheveux et se ferait passer pour « Jean Barret », le valet du botaniste. Un tel déguisement n’était pas simplement une question de vêtements : elle devait adopter les manières, les gestes et le langage des hommes pour ne pas être démasquée. Le pari était osé. Si elle était découverte, elle risquait d’être expulsée, ridiculisée, voire emprisonnée. Mais Jeanne était prête à braver ces dangers pour accomplir son rêve d’exploration.
En décembre 1766, elle embarqua avec Commerson sur l’Étoile, l’un des navires de l’expédition de Bougainville. Le voyage commençait.
Sur un navire du XVIIIe siècle, la vie était loin d’être confortable, et pour Jeanne, la tension était constante. L’Étoile, navire d’appoint de l’expédition, transportait une soixantaine d’hommes, entassés dans des cabines étroites et humides. Les jours étaient rythmés par le bruit des vagues, le grincement du bois et les ordres des officiers. Pour cacher son identité, Jeanne évitait autant que possible les regards et les interactions. Elle restait proche de Commerson, qui bénéficiait d’une cabine plus spacieuse où il entreposait ses spécimens botaniques. Là, à l’abri des regards indiscrets, elle participait activement à la collecte et au tri des plantes, jouant un rôle essentiel dans les travaux scientifiques de l’expédition. À chaque escale, de nouvelles merveilles botaniques attendaient d’être découvertes. À Rio de Janeiro, Jeanne et Commerson explorèrent les forêts tropicales, rapportant des dizaines de spécimens inconnus en Europe. C’était une époque où la nature semblait infinie et où chaque plante trouvée représentait une pièce d’un immense puzzle scientifique.
Mais ce fragile équilibre fut brisé lors de l’arrivée à Tahiti, en avril 1768. Là-bas, les Polynésiens reconnurent immédiatement Jeanne comme une femme, malgré son déguisement. Comment ? Les récits divergent : certains évoquent ses traits ou sa démarche, d’autres suggèrent que son secret était déjà suspecté par l’équipage. Lorsque sa véritable identité fut dévoilée, le scandale éclata. Sur un navire militaire, la présence d’une femme était perçue comme une entorse grave et surtout comme une malédiction. Pas de femme sur un bateau! Jeanne dut faire face à l’hostilité de certains membres de l’équipage, ainsi qu’aux moqueries. Pourtant, elle parvint à convaincre Bougainville et le capitaine Duclos-Guyot de la laisser continuer le voyage.
Malgré les difficultés, Jeanne continua de travailler aux côtés de Commerson, jouant un rôle clé dans la collecte de milliers de spécimens botaniques. Parmi leurs découvertes figurait une plante qui allait devenir l’un des emblèmes de l’expédition : le Bougainvillea, cette fleur éclatante et colorée découverte au Brésil, qui porte aujourd’hui le nom du chef de l’expédition. Ces découvertes enrichirent les collections européennes et contribuèrent à faire progresser la connaissance de la flore mondiale. Mais si le nom de Commerson fut associé à ces succès, celui de Jeanne resta longtemps dans l’ombre.
Après son retour en France en 1775 avec son mari Jean Dubernat, un ancien soldat qu’elle avait épousé à l’île Maurice, Jeanne Barret retrouva une vie modeste dans sa région natale de Bourgogne. Installée près de son village d’enfance, elle vécut loin des aventures qui avaient marqué sa jeunesse, menant une existence simple et paisible. En 1785, elle reçut une pension royale de 200 livres de Louis XVI, en reconnaissance de son rôle dans l’expédition de Bougainville et des travaux scientifiques qu’elle avait menés aux côtés de Philibert Commerson. Bien que ce geste fût exceptionnel pour une femme de son époque, son apport scientifique resta largement oublié, éclipsé par les exploits masculins de l’expédition. Jeanne mourut en 1807 à l’âge de 67 ans, dans une relative obscurité. Ce n’est qu’au XXe siècle que les historiens redécouvrirent son histoire et lui rendirent justice, la célébrant comme une pionnière de l’exploration et une femme ayant défié avec courage les normes de son époque.
Je lui rends un peu de postérité ici.
L’histoire de Jeanne Barret est celle d’une femme qui, contre vents et marées, choisit de vivre pleinement sa passion. Son nom mérite d’être inscrit aux côtés des grands explorateurs, car si le monde était encore vaste et mystérieux à son époque, elle l’a affronté avec une audace qui inspire encore aujourd’hui.
Découvrez d'autres histoires sur les femmes: ici
Découvrez d'autres voyages extraordinaires: ici
Découvrez une la découverte de Tahiti par Bougainville: ici
Découvrez d'autres histoires de la période Moderne en cliquant : ici
Retrouvez-nous sur Facebook en cliquant: ici
Retrouvez-nous sur Instagram en cliquant : ici
Un message à nous envoyer: lesitedelhistoire2@laposte.net
Toutes les images d'illustration appartiennent à l'auteur. Si vous voulez les utiliser, merci de bien vouloir demander l'autorisation par mail.


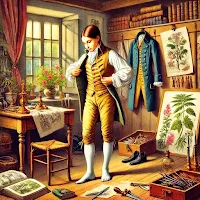


Commentaires
Enregistrer un commentaire