La redécouverte du sarcophage de Thoutmôsis II : Plongée dans la vie d’un pharaon effacé de l’Histoire
En février 2025, l’annonce fait l’effet d’un séisme dans le monde de l’égyptologie : la tombe de Thoutmôsis II, longtemps restée introuvable, est enfin mise au jour dans les ouadis occidentaux de Thèbes. Cette découverte, au-delà de son importance archéologique, pose une question fascinante : pourquoi ce pharaon, pourtant légitime et puissant, a-t-il été systématiquement effacé des mémoires ? Son règne a-t-il été volontairement occulté par son épouse Hatchepsout et son fils Thoutmôsis III, ou a-t-il simplement été victime des pratiques de réappropriation courantes chez les souverains égyptiens ?
Thoutmôsis II naît au sein de la prestigieuse XVIIIe dynastie, fils du pharaon Thoutmôsis Ier et d’une épouse secondaire, Moutnofret. Son ascension sur le trône est facilitée par son mariage avec Hatchepsout, sa demi-sœur, qui est la fille de la grande épouse royale Ahmès. Cette union renforce sa légitimité, mais fait aussi d’Hatchepsout une figure incontournable du pouvoir. Son règne, bien que court (entre 3 et 13 ans selon les sources), semble avoir été plus important qu’on ne le pensait. Il mène plusieurs campagnes militaires, assure la continuité des grands projets architecturaux de son père et veille à la stabilité de l’Égypte. Pourtant, les traces de son règne sont aujourd’hui presque inexistantes. Les sources indiquent que Thoutmôsis II dut faire face à des rébellions dès son accession au trône. Une inscription trouvée à Assouan mentionne une expédition militaire en Nubie visant à réprimer un soulèvement. Si l’on ignore s’il y a personnellement participé, l’efficacité de cette campagne semble attestée par l’absence de troubles ultérieurs dans cette région sous son règne. Il aurait également conduit une expédition militaire contre des tribus bédouines d’Asie (probablement en Palestine ou dans le Sinaï), une pratique courante pour les souverains égyptiens cherchant à sécuriser leurs frontières orientales. Là encore, les détails manquent, mais ces interventions suggèrent que Thoutmôsis II ne fut pas un pharaon passif, bien au contraire.
Malgré un règne court, Thoutmôsis II initie plusieurs projets architecturaux, dont certains seront achevés ou repris par Hatchepsout et Thoutmôsis III. À Karnak, il lance la construction d’une grande cour devant l’entrée du temple, un projet que son successeur poursuivra. Sur la rive occidentale de Thèbes, il commence un temple funéraire, mais celui-ci sera agrandi et modifié par ses successeurs. Il est probable qu’il ait aussi commandé d’autres structures aujourd’hui perdues ou réattribuées à d’autres pharaons. Son effacement progressif du paysage monumental égyptien pose donc une question essentielle : ses successeurs ont-ils simplement suivi la tradition de "recycler" les œuvres de leurs prédécesseurs pour en tirer gloire, ou son nom a-t-il été sciemment effacé pour des raisons politiques ?
À la mort de Thoutmôsis II, son fils Thoutmôsis III (né d’une épouse secondaire) est encore un enfant. Hatchepsout assure donc la régence, mais au lieu de se contenter d’un rôle de tutrice, elle s’impose progressivement comme souveraine à part entière. Se proclamant "roi" et non "reine", elle adopte les attributs masculins des pharaons et gouverne seule pendant plus de 20 ans. Pour asseoir son autorité, il est probable qu’elle ait minimisé l’héritage de Thoutmôsis II en récupérant ses réalisations architecturales et en limitant la mention de son nom dans les inscriptions officielles. Toutefois, elle ne l’efface pas totalement, peut-être pour préserver une certaine continuité dynastique.
Le véritable effacement de Thoutmôsis II semble survenir sous le règne de Thoutmôsis III. Après la mort d’Hatchepsout, ce dernier entreprend une campagne de damnatio memoriae contre elle, faisant marteler son nom sur les monuments et effaçant toute trace de son règne. Dans cette purge systématique, Thoutmôsis II disparaît lui aussi en grande partie. Pourquoi ? Était-ce une simple conséquence de la destruction des œuvres d’Hatchepsout, ou y avait-il une volonté délibérée de minimiser son rôle dans l’histoire ? Il est possible que Thoutmôsis III, soucieux d’être perçu comme l’héritier légitime d’un grand pharaon militaire, ait préféré se positionner directement en successeur de Thoutmôsis Ier, sautant ainsi une génération. En effaçant les traces de son père et d’Hatchepsout, il pouvait se présenter comme le véritable restaurateur du pouvoir royal.
Jusqu’à récemment, la sépulture de Thoutmôsis II restait un mystère. Bien que sa momie ait été retrouvée en 1881 dans la cachette royale de Deir el-Bahari, son tombeau originel demeurait inconnu. En 2022, une équipe archéologique anglo-égyptienne découvre une tombe dans les ouadis occidentaux de Thèbes, désignée sous le nom de C4. Ce n’est qu’en 2025 que des analyses plus approfondies permettent de confirmer qu’il s’agit bien de la tombe de Thoutmôsis II. Ce tombeau, construit sous des cascades naturelles, a été fortement endommagé par les crues au fil des millénaires. À l’intérieur, les archéologues trouvent des fragments d’inscriptions, des vases au nom de Thoutmôsis II et d’Hatchepsout, ainsi qu’un plafond peint en bleu parsemé d’étoiles jaunes, un motif souvent utilisé pour représenter le ciel nocturne et l’au-delà. La découverte de cette tombe offre une opportunité unique de réévaluer son règne. Les inscriptions et objets retrouvés pourraient révéler des informations inédites sur son gouvernement, ses relations avec Hatchepsout et les circonstances de son effacement historique.
L’effacement de Thoutmôsis II soulève une question fondamentale : A-t-il simplement été victime du recyclage habituel des réalisations pharaoniques, où chaque souverain cherche à s’approprier les œuvres de ses prédécesseurs pour en tirer gloire ? Ou bien son règne a-t-il été volontairement occulté parce qu’il représentait une menace pour la légitimité de ceux qui lui ont succédé ? Si son règne avait été insignifiant, pourquoi ses successeurs auraient-ils pris la peine d’effacer son nom de tous les monuments ? Serait-il possible qu’il ait laissé un héritage trop important, risquant d’éclipser à la fois Hatchepsout et Thoutmôsis III ? La découverte de sa tombe nous rapproche peut-être d’une réponse. Au fil des fouilles et des études, il est possible que Thoutmôsis II retrouve enfin la place qui lui revient dans l’histoire de l’Égypte antique.
Claude Vandersleyen, Hatchepsout : La reine qui devint pharaon, Éditions Pygmalion, 2011.
Toby Wilkinson, The Rise and Fall of Ancient Egypt, Éditions Random House, 2010.
Découvrez d'autres histoires égyptiennes en cliquant: ici
Retrouvez-nous sur Instagram en cliquant : ici
Retrouvez-nous sur Facebook en cliquant: ici
Un message à nous envoyer: lesitedelhistoire2@laposte.net
L'image d'illustration appartient à l'auteur. Si vous voulez l'utiliser, merci de bien vouloir demander l'autorisation par mail.





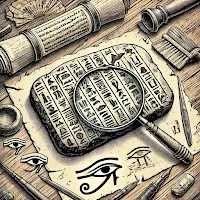
Commentaires
Enregistrer un commentaire