Le Vasa : vaisseau amiral suédois
En 1626, la Suède protestante déclare la
guerre à la Pologne
catholique. Sa flotte est vétuste et elle perd de nombreux navires. Le roi
Gustave Adolphe II décide de reconstruire sa flotte, dont le navire le plus
puissant portera le nom de la dynastie régnante : Vasa.
Le roi passe commande à deux
ingénieurs hollandais Henrik Hybertsson et Arendt de Groote. Le premier
travaille en Suède depuis vingt ans. Il a déjà construit des navires pour la
couronne. A l’époque, les Hollandais sont réputés pour être les meilleurs
ingénieurs navals d’Europe. Les deux hommes doivent construire 80 navires en
quatre ans, dont le Vasa. Le budget alloué au vaisseau amiral équivaut à 25%
des revenus du pays.
Stockholm comprend un port et des
chantiers navals. Ils sont installés à quelques centaines de mètres de la
vieille ville sur la presqu’île de Blaisy Olsun en face du palais. Employant
400 personnes, il s’agit de la plus grande entreprise de la ville. Plusieurs
langues s’entendent dans l’arsenal, car les ingénieurs viennent pour la plupart
de l’étranger. Les outils et les chevilles en fer sont fabriqués sur place dans
les forges. Le chantier naval emploie aussi des femmes. Elles fabriquent les
chandelles utilisées sur les navires et tissent les voiles. Les navires sont
fabriqués en chênes abattus exclusivement sur ordre de la couronne en hiver et traîner
jusqu’au fleuve pour être remorqués. Le type de bois varie en fonction du
navire construit.
Le 2 novembre 1626, Henrik
Hybertsson s’attèle à la construction des deux plus petits navires et commande
le bois en conséquence. Néanmoins souhaitant rapidement impressionner ses
ennemis, le roi insiste pour faire du Vasa la priorité. Le bois choisi n’est
donc plus adapté. Il faut repartir à la coupe. De plus, le bateau est financé à
crédit. La couronne ne paiera qu’une fois le navire livré. Hybertsson doit
avancer l’argent. Il s’en plaint à plusieurs reprises au palais. Arendt de Groote
emprunte des sommes importantes auprès de banquiers hollandais.
En mai 1627, Henrik Hybertsson
décède de maladie. Son épouse Margaretha lui succède. Une veuve est autorisée à
reprendre les affaires de son mari. Elle doit faire face à des grèves. Les
ouvriers, n’ayant pas été payés depuis plusieurs mois, refusent de poursuivre
le travail. Les grèves étant interdites, les meneurs sont pendus. Le 16 janvier
1628, Gustave Adolphe II se rend sur place pour constater l’avancement des
travaux. Bien que la coque soit achevée, le roi s’étonne du retard accumulé et
de la mauvaise gestion du chantier. Margaretha rétorque qu’elle a des problèmes
de trésorerie dus au fait que le roi n’a pas payé. Le budget prévu pour le Vasa
est de 40.000 dallers, or la coque en a déjà coûté 53.000.
Henrik et Margaretha Hybertsson
emploient la méthode hollandaise qui consiste à assembler les planches de la
proue et de la poupe puis à monter le bordage. Mille chênes et 8000 chevilles
en fer sont nécessaires à sa construction. Le cordage, en chanvre de Lettonie,
est fabriqué à la corderie de Rikanonberg. Il s’agit d’un ancien monastère
transformé dans lequel des orphelins travaillent en échange du gîte et du
couvert. Les grues chargent les 64 canons, qui se répartissent sur les deux
ponts inférieurs, et les 2000 tonneaux de nourriture soit des rations pour deux
mois. Des ouvriers marchent dans d’énormes roues pour treuiller les câbles. Les
habitants défilent sur le quai pour admirer ce gigantesque navire mesurant 50 mètres de haut pour 69
de long et comportant dix voiles. La poupe est décorée de motifs dorés et ornée
de sculptures peintes avec des couleurs vives. Le but est de montrer la puissance
et la richesse de la Suède. Söfrig
En juillet 1628, le navire est
enfin prêt. Néanmoins, les pluies abondantes et les vents violents ne
permettent pas une sortie du port. Un navire de ce calibre est difficilement manœuvrable.
Le dimanche 10 août 1628, les conditions météorologiques sont réunies. Les
habitants se pressent sur le quai pour assister au spectacle. Pour son voyage
inaugural, le Vasa rejoindra la petite ville de Bagson située à une vingtaine
de kilomètres. A cette occasion, les femmes et les enfants des marins reçoivent
l’autorisation de monter à bord. Ils descendront à Bagson, où des soldats
doivent embarquer pour combattre en Allemagne.
Le vent est si faible qu’il faut
haler le Vasa hors du port. Au bout de deux heures, les grandes voiles sont hissées
et la salve traditionnelle est tirée. Le navire est instable et tangue trop.
Une rafale de vent brutale le penche. L’eau s’infiltre par les sabords. Le
bateau pique vers l’avant. Les matelots déplacent les canons pour faire
contrepoids, mais il est déjà trop tard. Les personnes du pont inférieur
périssent noyés. L’équipage se résout à quitter le navire. Vers 18 heures, le Vasa
a sombré. Sur les 130 personnes à son bord, 40 décèdent.
Le grand amiral envoie une lettre
au roi parti guerroyer en Allemagne, pour l’informer du drame et lui signifier
qu’il ouvre une enquête sur les circonstances du naufrage. Söfrig Hanson est
emprisonné. Interrogé, le capitaine affirme que le Vasa comportait trop de
défauts de fabrication et réagissait mal aux manœuvres. Il est libéré contre
caution et chargé du renflouage du navire, c'est-à-dire repêcher l’épave gisant
à trente mètres de profondeur. L’opération s’avère trop difficile et seuls les
canons sont remontés à la surface.
Le 5 septembre 1628, le
Grand-amiral préside une commission chargée de châtier les coupables. Erik
Kremer, le Vice-amiral était présent à bord. Accusé d’avoir manqué à ses
fonctions, il répond qu’il est descendu aider l’équipage à déplacer les canons
pour faire contrepoids et qu’il a failli se noyer. Il ajoute qu’il n’est pas
marin de métier qu’il n’avait en charge que l’armement du vaisseau. Il conclut
en rappelant que les questions de navigation sont du ressort du capitaine et de
son second. La commission le convoque. Lui et le capitaine ont constaté que le
Vasa était un navire instable. Il raconte que l’Amiral Klas Fleming a
interrompu un essai de roulis de peur que le navire chavire dans le port. La
commission convoque Arendt de Groote et l’interroge sur les erreurs de
conception. Il a suivi les instructions du roi à la lettre. La commission ne
peut désigner un responsable et classe l’affaire. Cependant, Margaretha Hibernsold
est renvoyée du chantier naval et ses livres de compte sont saisis. Son fils
est arrêté et probablement exécuté, car il n’y a plus aucune trace de lui après
le procès. Arendt de Groote quitte la
Suède.
L’épave, redécouverte en 1950,
est remontée le 24 avril 1961 sous les yeux du roi Gustave Adolphe VI,
descendant de Gustave Adolphe II qui n’a jamais vu ce navire. Les recherches
récentes ont démontré que le navire présentait un défaut d’équilibrage. Compte
tenu du gabarit du navire, il aurait fallu 220 tonnes de pierre pour lester
correctement le navire. Or vu la dimension de la cale, il n’a été embarqué que
120 tonnes de pierre. Entreposé au Musée Vasa et reconstruit à 95%, il présente
une imagé figée d’un navire européen du XVIIe siècle et constitue une
attractivité culturelle de la ville de Stockholm. De nos jours, le syndrome de
Vasa désigne l’échec d’un projet faute de communication et de prise de
responsabilité des différentes personnes impliquées.
Sources
Texte :
WAHLGREN Anders, Stockholm 1628 :
l’aventure du Vasa, Suède, 2011, 100min.
Image :
http://mondesetmerveilles.centerblog.net/243-le-navire-le-vasa?ii=1
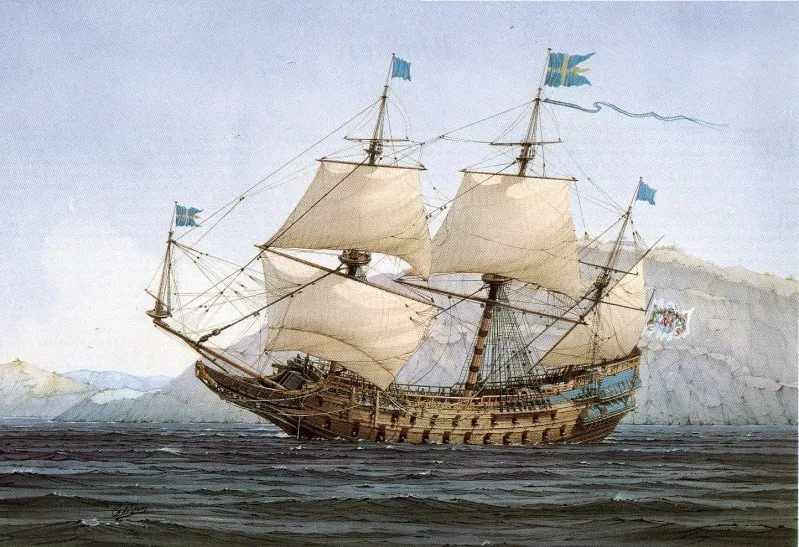
Commentaires
Enregistrer un commentaire